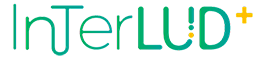La logistique urbaine est un secteur à enjeu : intensification du e‑commerce, pression sur les délais de livraison, impératifs environnementaux, transformation des mobilités. Les observatoires logistiques, à différentes échelles, jouent un rôle clé dans la compréhension de ces dynamiques. Une meilleure connaissance favorise l’aide à la décision pour rendre la logistique urbaine plus durable. Quelles ressources et données sont disponibles ? Quels indicateurs permettent d’observer le système logistique ? À quelles échelles les analyser ? Et surtout, quels sont les besoins de connaissance des acteurs économiques et des fédérations ? Cet article explore ces questions en examinant des observatoires dont les échelles d’études diffèrent : national, régional (Grand Est, Bretagne, Île‑de‑France) et local (Lyon–Saint‑Étienne).
Échelle nationale : l’Observatoire national de la logistique urbaine et le tableau de bord national
A l’échelle nationale, l’Observatoire national de la logistique urbaine rassemble une vaste collection d’études et des documents sur différents sujets relatifs à la logistiques urbaines comme la logistique fluviale, les parcs de véhicules, les métiers logistiques, sur le e‑commerce, les chaines d’approvisionnement, la cyclo-logistique, le foncier…). Il constitue une bibliothèque structurée, favorisant le partage des connaissances. Cet observatoire identifie également les acteurs impliqués dans la production de données et de contenus, tels que, par exemple, le programme InTerLUD+ ainsi que les laboratoires du LAET ou du VMT du CEREMA..
Un exemple de production compilant des données à l’échelle nationale est le tableau de bord national, construit par l’Université Gustave Eiffel pour la DGITM. Ce tableau de bord suit des indicateurs permettant de situer les dynamiques régionales dans un cadre national.
Des observatoires à l’échelle régionale
Pour étudier les dynamiques régionales Les observatoires régionaux jouent un rôle essentiel. Nous étudierons 3 exemples :
L’Observatoire Régional Transports & Logistique (ORT&L) de la région Grand-Est propose des études ainsi qu’un tableau de bord complet, intégrant flux de marchandises, foncier logistique, emplois, émissions et infrastructures. Cela permet d’éclairer les enjeux d’aménagement et de transition, notamment dans une région industrielle et transfrontalière.
En Île-de-France, l’OFELIF met l’accent sur la densité logistique exceptionnelle de la région qui crée des défis liés à la pollution et ou à la congestion urbaine. L’OFELIF met à disposition un tableau de bord, des cartes et des ressources sur les flux, le foncier, l’environnement ou les performances sociaux économiques afin d’offrir aux décideurs une vue d’ensemble de la région la plus productive et la plus peuplée de France.
En Bretagne, L’observatoire régional des transports dispose d’un volet logistique comme l’ORT&L. Cet observatoire suit également des indicateurs équivalents aux deux premiers dans un tableau de bord et propose des ressources. Comme en région Grand-Est, des temps d’échange sont également portés par l’Observatoire comme des rencontres régionales de la logistique réunissant des acteurs publics et privés.
Ces trois observatoires, complémentaires, fournissent aux acteurs économiques et aux collectivités des outils adaptés à leurs réalités, facilitant la prise de décision et la transition vers une logistique urbaine plus durable. Quelques villes commencent à vouloir créer leurs propres observatoires pour suivre les dynamiques et prendre des mesures pour orienter la logistique.
Échelle locale – l’Observatoire de la Logistique des Biens & Services (Lyon–Saint‑Étienne)
C’est par exemple le cas de l’observatoire de la logistique des biens et services porté par La Métropole de Lyon, L’Inter-Scot Lyon – Saint-Etienne et SYTRAL Mobilités. Cet observatoire, dont le périmètre correspond à l’aire métropolitaine Lyon – Saint-Etienne, propose des chiffres clés et des indicateurs sur des thématiques similaires aux autres observatoires (flux (fluviaux, routiers et ferroviaires), environnement, emploi et foncier. Sont également disponibles des cartes et des publications logistiques.
Cet observatoire s’est doté d’instances permettant un travail de concert avec les acteurs publics et privés afin de récupérer des données et de permettre des scènes d’échange avec l’ensemble des acteurs.
Nous pouvons noter que les sources utilisées par l’ensemble de ces territoires sont relativement similaires. Par exemple, pour les flux routiers, ils émanent des enquêtes du Service des Données et Etudes Statistiques (SDES)
Par ailleurs, d'autres territoires ont inscrit la création d'un observatoire logistique dans leur charte de logistique urbaine durable. C'est notamment le cas pour l'Eurométropole de Metz ou CAP Nord en Martinique.
Les acteurs économiques, parties prenantes de ces observatoires
Les observatoires logistiques fournissent aux acteurs économiques des outils précieux pour orienter leurs décisions. Les acteurs économiques s’en servent pour localiser les infrastructures et activités et pour anticiper les mutations du secteur (e-commerce, véhicules propres). Cela permet d’optimiser leurs implantations en fonction des réseaux de transport et du foncier disponible. Les fédérations, qu’elles soient nationales ou régionales, disposent ainsi de données chiffrées pour comparer les territoires, construire des benchmarks et appuyer leurs démarches auprès des pouvoirs publics.
Conclusion
Face aux enjeux relatifs au transport de marchandises en ville, les observatoires de la logistique apparaissent comme des outils indispensables pour structurer une action publique et privée plus efficace en matière de logistique urbaine. Qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux, ces dispositifs permettent de mieux connaître les dynamiques à l’œuvre, de comparer les territoires, d’objectiver les décisions et de favoriser le dialogue entre acteurs publics et économiques. En permettant le partage des données, la production d’indicateurs et le dialogue entre parties prenantes, les observatoires renforcent la capacité des territoires à construire des politiques logistiques plus durables et adaptées à leurs spécificités. L’enjeu désormais est d’élargir ces démarches, d’enrichir les données disponibles, et d’accompagner les collectivités dans la mise en place d’outils similaires, pour que chaque territoire puisse « mieux agir » grâce à une meilleure connaissance.